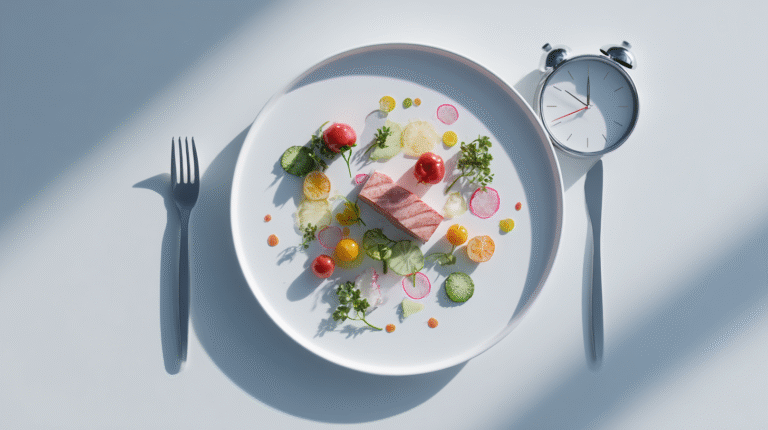Pas le temps de tout lire ? Un trouble neurovisuel relève du cerveau, pas de l’œil : il cause des difficultés chez l’enfant (lecture) ou l’adulte (orientation), malgré une vue normale. Un diagnostic tardif mène à des choix professionnels inadaptés. 1 enfant sur 30 vit des troubles méconnus, impactant son parcours scolaire et professionnel.
Vous soupçonnez un trouble neurovisuel ? Vos yeux captent parfaitement les images, mais votre cerveau peine à les interpréter, créant une dissonance frustrante au quotidien : lire devient un parcours du combattant, se garer un casse-tête, ou reconnaître un proche dans une foule un défi inattendu. Ce trouble cérébral, souvent méconnu, peut expliquer une maladresse chronique, des difficultés scolaires inexplicables ou une gêne face aux environnements surchargés. Dans cet article, je décortique les signes révélateurs, les causes méconnues et les solutions concrètes, de la rééducation orthoptique aux aménagements pratiques, pour retrouver un quotidien apaisé. Parce que comprendre son trouble, c’est déjà un pas vers son apaisement.
- « Mon œil voit bien, mais mon cerveau ne comprend pas » : qu’est-ce qu’un trouble neurovisuel ?
- Les signes qui doivent alerter : comment reconnaître un trouble neurovisuel au quotidien ?
- D’où viennent les troubles neurovisuels ? les causes derrière le symptôme
- Le diagnostic : un parcours complexe pour mettre un nom sur les maux
- L’impact sur l’avenir : le piège de la mauvaise orientation scolaire et professionnelle
- Prise en charge et rééducation : des solutions existent pour mieux vivre au quotidien
- Votre opticien, un allié pour votre confort visuel global
« Mon œil voit bien, mais mon cerveau ne comprend pas » : qu’est-ce qu’un trouble neurovisuel ?
Vous avez déjà eu cette sensation étrange ? Vos yeux perçoivent parfaitement les détails, votre dernière visite chez l’ophtalmologiste le confirme, et pourtant, vous peinez à lire une carte routière ou à garer votre voiture. Votre enfant, pourtant doté d’une vue irréprochable, accumule les erreurs d’écriture et bute sur les exercices de géométrie à l’école. Ce scénario familier cache peut-être un trouble neurovisuel, une difficulté invisible liée au cerveau, pas à l’œil.
Imaginez que vos yeux soient une caméra ultra-haute définition : ils capturent le monde avec une netteté parfaite. Le trouble neurovisuel, lui, est comme un bug dans le logiciel qui traite ces images. Le câble entre la caméra et l’écran fonctionne mal, ou le processeur interprète mal les données. Résultat : l’image arrive, mais le cerveau peine à la décoder. Ce n’est pas un problème de « lentille » (l’œil), mais bien du « circuit électronique » (le cerveau) qui analyse les informations visuelles.
Contrairement à la myopie ou à l’hypermétropie, les troubles neurovisuels (TNV) ne se corrigent pas avec des lunettes ou une chirurgie. L’acuité visuelle est souvent normale, mais le cerveau, notamment les aires cérébrales comme le cortex visuel ou les régions pariétales, a du mal à traiter l’information. C’est le cas de l’agnosie visuelle (reconnaissance défaillante d’objets) ou de l’hémianopsie latérale homonyme (perte d’un côté du champ visuel), où le patient voit « la moitié du film » sans en comprendre la logique. Ces troubles passent souvent inaperçus, car personne ne soupçonne une origine cérébrale quand les yeux sont sains.
Les signes qui doivent alerter : comment reconnaître un trouble neurovisuel au quotidien ?
Les difficultés neurovisuelles passent souvent inaperçues. Un enfant qui perd souvent sa ligne en lisant ou un adulte qui se cogne régulièrement aux meubles ? Derrière ces signes, un trouble neurovisuel peut perturber la perception, malgré une vision fonctionnelle. Ce trouble, dû à des lésions cérébrales dans le cortex visuel ou les régions pariétales, affecte la reconnaissance d’objets (agnosie), la lecture (alexie) ou la perception spatiale (hémianopsie latérale). Contrairement à un problème oculaire, l’œil capte correctement les images, mais le cerveau peine à les interpréter.
Chez les enfants, ces manifestations sont confondues avec un trouble d’apprentissage. En lecture, certains sautent des mots, confondent b/d ou lisent plus lentement que leurs camarades. L’écriture est irrégulière, avec des oublis fréquents en recopiant un texte ou en alignant des chiffres. Des gestes simples comme lacer ses chaussures ou attraper un ballon deviennent frustrants, générant un découragement qui se traduit par un repli sur soi ou une perte de confiance. Sans diagnostic, ces difficultés risquent un échec scolaire aggravant le découragement.
Chez les adultes, la conduite devient angoissante : apprécier les distances ou éviter un obstacle est parfois un défi. Dans un supermarché, retrouver un produit déclenche une surcharge mentale, comme résoudre un puzzle avec des pièces manquantes. Certains peinent à reconnaître des visages (prosopagnosie), confondant des collègues de bureau ou des membres de la famille. D’autres perdent une moitié de leur champ visuel (hémianopsie), rendant la lecture d’un livre ou la conduite sur autoroute périlleuses. Les chutes fréquentes ou la désorientation dans des lieux familiers doivent alerter, surtout après un événement cérébral comme un AVC ou un traumatisme.
- Difficultés à lire : sauts de lignes, confusion de lettres similaires (b/d).
- Maladresse anormale : heurter les meubles, renverser des objets.
- Problèmes d’orientation : se perdre dans des lieux familiers.
- Gêne face à la foule ou aux motifs complexes.
- Difficultés à reconnaître des visages connus (prosopagnosie).
- Lenteur excessive pour copier un texte ou un dessin.
D’où viennent les troubles neurovisuels ? les causes derrière le symptôme
Quand un trouble neurovisuel survient, les yeux ne sont pas en cause. L’origine est toujours cérébrale. Le cerveau peine à traiter correctement les informations visuelles, même si l’acuité visuelle reste normale. C’est comme un ordinateur qui reçoit une image claire, mais dont le processeur défaillant ne parvient pas à l’interpréter.
Chez l’adulte, l’AVC est la cause la plus fréquente. Une lésion dans les régions occipitales, siège du traitement visuel, touche un tiers des patients victimes d’un accident vasculaire cérébral. Les traumatismes crâniens (chutes, accidents) ou les tumeurs cérébrales peuvent aussi perturber ces zones. Même certaines maladies neurodégénératives, comme Alzheimer ou Parkinson, impactent progressivement la perception visuelle, sans que la rétine ou le nerf optique soient touchés.
Chez l’enfant, la grande prématurité (naissance avant 32 semaines d’aménorrhée) fragilise le développement cérébral. Les vaisseaux sanguins du cerveau, encore immatures, peuvent se rompre, entraînant des hémorragies intra-ventriculaires ou des lésions de la substance blanche. L’anoxie néonatale, un manque d’oxygène à la naissance, aggrave cette vulnérabilité, perturbant la maturation des voies visuelles centrales. Ces lésions acquises précocement affectent durablement la reconnaissance d’objets, l’orientation spatiale ou la lecture.
Comprendre ces causes est essentiel pour une prise en charge adaptée. Que ce soit après un AVC, une prématurité ou une maladie neurodégénérative, l’atteinte cérébrale doit être identifiée pour orienter les rééducations. Les progrès en imagerie cérébrale, comme l’IRM, permettent désormais de localiser précisément les zones impactées, même des années après l’événement déclencheur. C’est une première étape vers un accompagnement personnalisé.
Le diagnostic : un parcours complexe pour mettre un nom sur les maux
Pourquoi le diagnostic est-il si difficile ?
Beaucoup de patients entendent pendant des années « votre vue est bonne » sans trouver d’explication à leurs difficultés. Ce décalage entre leur ressenti et les résultats classiques s’explique par la nature même des troubles neurovisuels : les yeux fonctionnent parfaitement, mais le cerveau traite mal l’information visuelle.
Imaginez un téléviseur HD parfaitement réglé, mais avec un décodeur défectueux. L’image arrive sans altération, mais le cerveau, comme le décodeur, n’interprète pas correctement les signaux. Ce phénomène explique pourquoi les examens ophtalmologiques standards restent souvent muets.
Le rôle central du bilan neurovisuel
Seul un bilan neurovisuel spécialisé permet d’identifier ces troubles cérébraux. Contrairement au bilan orthoptique classique qui vérifie le bon fonctionnement des yeux, ce dernier explore les mécanismes cérébraux de traitement visuel.
Les professionnels évaluent la poursuite oculaire (capacité à suivre un objet en mouvement), le balayage visuel (exploration visuelle efficace), la perception spatiale et la reconnaissance des formes. Ces tests permettent de comprendre pourquoi un enfant peut parfaitement distinguer un oiseau mais ne pas reconnaître son dessin stylisé.
L’expertise pour les enfants : les batteries de tests standardisées
Chez les jeunes patients, les professionnels utilisent des batteries de tests standardisées comme les tests EVA (Évaluation Visuelle de l’Attention) ou BAJE (Batterie d’Analyse des Jeux d’Échecs). Ces outils, spécialement conçus pour les enfants, permettent d’évaluer objectivement des compétences souvent invisibles à l’œil nu.
Par exemple, un enfant peut réussir à identifier un triangle rouge mais échouer lorsqu’on lui demande de le retrouver parmi des formes similaires. Ces tests montrent l’importance d’une approche méthodique et scientifique pour déceler des troubles qui se cachent derrière une vision périphérique normale.
| Trouble | Origine principale | Symptômes clés |
|---|---|---|
| Trouble Neurovisuel (TNV) | Cerveau (traitement de l’info visuelle) | Difficulté d’analyse spatiale, de reconnaissance, de coordination, malgré une bonne vue |
| Trouble de l’attention (TDA/H) | Neurodéveloppemental (fonctions exécutives) | Inattention, impulsivité, hyperactivité, non spécifiquement visuels |
| Dyspraxie | Neurodéveloppemental (planification du geste) | Maladresse gestuelle, difficultés de coordination motrice (pas seulement visuo-motrice) |
| Trouble visuel « classique » (myopie, etc.) | Œil (défaut de focalisation) | Vision floue de près ou de loin, corrigible par des lunettes |
L’impact sur l’avenir : le piège de la mauvaise orientation scolaire et professionnelle
Un trouble neurovisuel non diagnostiqué peut transformer une difficulté en série d’échecs. Un enfant peinant à reconnaître les lettres malgré une vision parfaite se persuade d’être « mauvais en lecture », alors que son cerveau peine à interpréter les signaux visuels. À l’âge adulte, des chutes fréquentes ou une incapacité à se repérer dans un espace familier sont souvent attribuées à de la maladresse, occultant un trouble cérébral sous-jacent. En effet, 2 à 3 % des enfants de 5 ans pourraient présenter un TNV, souvent confondu avec un simple « manque de concentration » en classe. Chez l’adulte, ces défis persistent : des difficultés d’orientation, de lecture ou de concentration modifient radicalement la vie quotidienne.
L’orientation vers les métiers manuels est un piège dangereux. Un jeune dyspraxique orienté vers la mécanique, métier exigeant une coordination œil-main exceptionnelle pour ajuster des pièces microscopiques, se heurte à une tâche doublement complexe. Même les métiers du bâtiment, comme la maçonnerie, nécessitent une perception spatiale pour interpréter des plans ou aligner des structures. Un tailleur, souvent valorisé pour sa dextérité, doit en réalité couper des motifs avec une précision extrême, un défi insurmontable sans repérage visuel fiable. En chirurgie, où la perception spatiale est cruciale, 78 % des chirurgiens améliorent leurs performances grâce à l’entraînement, soulignant l’importance d’une évaluation préalable des capacités neurovisuelles.
Une orientation réussie repose sur la compréhension des forces cachées. Un adolescent avec un trouble de la reconnaissance visuelle peut exceller dans les métiers relationnels, valorisant son empathie et sa mémoire auditive. Un adulte souffrant d’hémianopsie latérale homonyme, limité à une moitié de champ visuel, pourrait s’épanouir dans l’édition audio, où la précision spatiale n’est pas requise. Comme le montre le parcours de Lise, dyspraxique réorientée vers le maquillage artistique, ou celui de Maël, devenu traducteur malgré des difficultés scolaires, la réussite réside dans l’adaptation aux compétences préservées. Un bilan neurovisuel préalable, couplé à des tests en entreprise, permet d’éviter les échecs évitables.
- Exemples de métiers exigeants sur le plan neurovisuel (à évaluer avec prudence)
- Métiers du bâtiment (maçon, électricien) : lecture de plans, alignement spatial.
- Métiers de l’artisanat d’art (bijoutier, horloger) : précision extrême sur de minuscules éléments.
- Conduite professionnelle (chauffeur, pilote) : gestion de l’espace tridimensionnel en temps réel.
- Chirurgie : coordination œil-main fine et lecture 3D d’une anatomie 2D.
Prise en charge et rééducation : des solutions existent pour mieux vivre au quotidien
Contrairement aux idées reçues, un trouble neurovisuel ne se « guérit » pas comme une fracture. Le cerveau possède une capacité d’adaptation étonnante : la plasticité cérébrale permet de créer de nouveaux circuits pour compenser des zones endommagées. Par exemple, un adulte victime d’un AVC peut apprendre à lire autrement, même des années après l’événement. Chez l’enfant, une prise en charge précoce peut même éviter des handicaps permanents liés à des difficultés spatiales ou à la reconnaissance visuelle.
La rééducation repose sur une équipe pluridisciplinaire. L’orthoptiste entraîne les yeux à mieux explorer l’espace via des exercices de suivi de cibles ou de coordination œil-main. L’ergothérapeute adapte l’environnement : code couleur sur les cahiers, écran d’ordinateur simplifié avec un fond gris pour réduire la surcharge visuelle. D’autres professionnels interviennent selon les troubles : psychomotricien pour les gestuels, orthophoniste pour le langage. En France, 5 % des enfants et un tiers des adultes après un AVC souffrent de ces troubles, souvent confondus avec la dyslexie ou le TDAH.
Les aides techniques transforment le quotidien. Des logiciels lisent les textes à haute voix, des filtres écran réduisent la fatigue liée à la lumière bleue. Un détail crucial : la prise en charge diffère de celle des maladies des yeux. Ici, on ne soigne pas l’organe, mais on construit des stratégies pour compenser. Un enfant avec des difficultés spatiales apprend à organiser son cahier avec des repères colorés ou à taper au clavier sans regarder les touches.
- Un diagnostic précoce pour comprendre l’origine des difficultés. Sans repérage avant le CP, un enfant peut grandir avec des handicaps évitables. La fondation « Les yeux dans la tête » milite pour des tests de dépistage à l’école maternelle.
- Une rééducation personnalisée avec orthoptiste, ergothérapeute… Chaque séance renforce la coordination œil-cerveau via des exercices ciblés. Des outils comme le casque EYESOFT aident à analyser les mouvements oculaires pour cibler les entraînements.
- Des adaptations de l’environnement scolaire ou professionnel pour réduire l’épuisement visuel. Un code couleur sur les manuels, un rangement structuré : des ajustements simples qui font toute la différence au quotidien.
Votre opticien, un allié pour votre confort visuel global
Les troubles neurovisuels sont des altérations complexes causées par des lésions cérébrales, affectant la reconnaissance d’objets, la lecture ou l’orientation spatiale malgré une acuité visuelle normale. Un diagnostic précis, souvent réalisé par un médecin ou un orthoptiste, permet d’identifier des pathologies comme l’agnosie visuelle ou l’alexie sans agraphie. Une prise en charge adaptée peut alors transformer le quotidien des patients.
En tant qu’opticien à Bailleul, je ne diagnostique pas ces troubles spécifiques. Mon rôle premier est de garantir que votre équipement optique – lunettes ou lentilles – soit parfaitement adapté à votre vision. Si un client, enfant ou adulte, exprime une gêne persistante malgré des corrections impeccables, j’écoute attentivement et préconise un bilan plus approfondi avec un professionnel médical. Cette collaboration entre opticiens, orthoptistes et ophtalmologistes est essentielle pour une prise en charge complète.
Pour moi, l’optique est bien plus qu’une transaction. C’est une relation de confiance, un accompagnement sur le long terme. Si des difficultés visuelles surgissent, même après un contrôle récent, n’hésitez pas à franchir la porte d’Optique Grand Place. Parfois, un simple échange permet d’identifier une piste oubliée. Mon engagement ? Votre confort visuel, en harmonie avec votre style de vie et vos besoins uniques.
Un trouble neurovisuel n’est pas une question de vue, mais un traitement cérébral du monde. Si des difficultés persistent avec des lunettes adaptées, un bilan approfondi est essentiel. À Bailleul, je suis votre allié pour un confort visuel global, en orientant vers les spécialistes. L’écoute attentive est la première étape vers une vie sereine.
FAQ
Quels sont les symptômes des troubles neurovisuels ?
Les troubles neurovisuels peuvent se manifester de façon surprenante. Chez l’enfant, on peut observer des difficultés à lire (sauts de mots ou de lignes), à écrire de manière ordonnée, à reconnaître des formes ou des lettres, ou encore de la maladresse inhabituelle. À l’école, cela peut se traduire par une lenteur excessive à copier un texte ou à résoudre des exercices géométriques. Chez l’adulte, les signes incluent des difficultés à conduire (appréciation des distances, stationnement), à se repérer dans un lieu familier, à retrouver un objet sur une étagère encombrée, ou encore à reconnaître un visage connu. C’est comme si vos yeux fonctionnaient parfaitement, mais que votre cerveau « buguait » pour interpréter correctement ce qu’ils captent.
Et contrairement aux troubles visuels classiques, ces difficultés persistent même avec une correction optique optimale. Elles ne s’expliquent pas par un défaut de l’œil, mais bien par un problème de traitement de l’information visuelle par le cerveau.
Qu’est-ce que les troubles neurovisuels ?
Les troubles neurovisuels sont des difficultés cérébrales dans le traitement de l’information visuelle, et non un problème d’acuité visuelle. C’est comme si vos yeux étaient une caméra ultra-haute définition qui capte parfaitement les images, mais que le logiciel qui traite ces images avait un « bug ». Contrairement aux troubles visuels classiques (comme la myopie ou l’hypermétropie), où l’œil lui-même a un défaut, ici c’est le cerveau qui a du mal à décoder correctement ce que vos yeux lui transmettent.
Ces troubles peuvent affecter la reconnaissance des visages, la perception spatiale, ou la compréhension d’une scène complexe. Imaginez que vos yeux transmettent des informations parfaitement nettes, mais que votre cerveau ait du mal à les organiser, à les interpréter ou à les relier à d’autres informations. C’est un peu comme si votre ordinateur recevait des données correctes mais avec un logiciel de traitement défaillant.
Qu’est-ce qu’un bilan neurovisuel ?
Le bilan neurovisuel est un examen pointu qui va bien au-delà d’un simple test de lecture. Il vise à comprendre comment votre cerveau traite l’information visuelle, en évaluant des compétences comme la poursuite oculaire (capacité à suivre un mouvement du regard), le balayage visuel (façon dont vos yeux explorent un espace), la perception de l’espace, la reconnaissance des formes, et la mémoire visuelle. C’est comme passer un « détecteur de défauts » sur l’ensemble du circuit visuel, de l’œil au cerveau.
Ce bilan est généralement réalisé par des professionnels spécialisés comme des orthoptistes ou des neuropsychologues, souvent en collaboration avec un neurologue ou un orthophoniste. Pour les enfants, il peut inclure des batteries de tests standardisées comme les tests EVA ou BAJE, qui ressemblent à de petits jeux mais permettent d’évaluer objectivement les difficultés. Ce n’est pas un examen « punitif » mais un outil précieux pour comprendre pourquoi certaines tâches visuelles peuvent être fatigantes ou difficiles.
Quels sont les symptômes des troubles neurologiques ?
Les troubles neurologiques peuvent se manifester par une grande variété de symptômes, qui dépendent de la zone du système nerveux touchée. Outre les symptômes neurovisuels que j’ai mentionnés (difficultés à lire, à s’orienter, à reconnaître des visages), on peut observer des maux de tête récurrents, des étourdissements, des pertes d’équilibre, des difficultés à coordonner les mouvements, ou des changements d’humeur inexpliqués. Certains troubles peuvent provoquer une vision floue, mais il faut distinguer ce cas des problèmes visuels classiques comme la myopie ou l’hypermétropie.
Dans certains cas, on peut noter des troubles du langage, de la mémoire, ou des changements dans la sensibilité corporelle. Si vous remarquez plusieurs de ces signes ensemble, je vous recommande de consulter votre médecin. Il saura vous orienter vers les spécialistes appropriés pour faire le point sur votre situation.
Quel trouble neurologique provoque une vision floue ?
Il faut bien distinguer la vision floue d’origine oculaire de celle qui pourrait être liée à un trouble neurologique. La plupart du temps, une vision floue est due à un problème de l’œil lui-même : myopie, astigmatisme, hypermétropie, ou presbytie. Ce sont des troubles visuels « classiques » que nous, opticiens, pouvons facilement corriger avec des verres adaptés.
En revanche, une vision floue d’origine neurologique est plus rare. Elle peut être liée à une atteinte cérébrale, comme un AVC, un traumatisme crânien, ou certaines maladies neurodégénératives. Dans ces cas, l’œil fonctionne correctement, mais le cerveau a du mal à interpréter correctement les images reçues. C’est comme si l’image arrivait clairement, mais que le cerveau avait du mal à la « mettre au point » pour la rendre exploitable.
Qui diagnostique un trouble neurovisuel ?
Le diagnostic d’un trouble neurovisuel repose sur une démarche pluridisciplinaire. Il commence souvent par un bilan neurovisuel effectué par un orthoptiste spécialisé ou un neuropsychologue. Ce bilan évalue comment votre cerveau traite l’information visuelle. Ensuite, d’autres professionnels peuvent intervenir : un neurologue pour identifier d’éventuelles atteintes cérébrales, un orthophoniste si le trouble affecte le langage, ou un psychomotricien si la coordination est impactée.
Pour les enfants, le diagnostic peut impliquer un pédiatre spécialisé en troubles du développement, un orthoptiste, un neuropsychologue scolaire, ou un enseignant spécialisé. Le diagnostic final est posé après analyse de tous ces éléments et après élimination d’autres causes possibles à vos difficultés visuelles. C’est un peu comme une enquête médicale où chaque spécialiste apporte une pièce du puzzle.
Qui peut prescrire un bilan neurovisuel ?
Plusieurs professionnels de santé peuvent orienter vers un bilan neurovisuel. Le plus souvent, c’est votre médecin traitant qui peut vous prescrire cet examen, après avoir constaté des symptômes persistants non expliqués par des problèmes visuels classiques. Un ophtalmologiste peut également le faire, notamment lorsqu’il constate des difficultés qui ne s’expliquent pas par l’acuité visuelle.
Des spécialistes comme les neurologues, pédiatres spécialisés en troubles du développement, ou encore des orthophonistes peuvent également demander un bilan neurovisuel quand ils soupçonnent un trouble du traitement cérébral de l’information visuelle. À noter que si vous êtes un patient curieux et concerné, vous pouvez aussi demander à votre médecin de vous orienter vers ce type d’examen. Votre instinct parental ou vos propres ressentis sont des indicateurs précieux.
Quels sont les troubles neuropsychiques ?
Les troubles neuropsychiques englobent un large éventail de difficultés qui touchent à la fois les fonctions cognitives et émotionnelles. Ce sont des troubles qui affectent le fonctionnement du cerveau dans des domaines comme la mémoire, l’attention, le langage, la perception, le raisonnement, ou encore la coordination. Ils peuvent se manifester par des difficultés d’apprentissage, des troubles du comportement, des problèmes d’adaptation sociale, ou des retards de développement.
Ils incluent des conditions comme le TDAH, l’autisme, les troubles du langage, ou les troubles de la mémoire. Il est important de bien distinguer ces troubles du trouble neurovisuel, qui concerne spécifiquement le traitement cérébral de l’information visuelle. Cependant, ces troubles peuvent coexister, ce qui rend le diagnostic parfois complexe. L’essentiel est d’identifier les difficultés réelles pour mettre en place des solutions adaptées.
Qu’est-ce que la rééducation neurovisuelle ?
La rééducation neurovisuelle est une approche thérapeutique visant à améliorer la façon dont le cerveau traite les informations visuelles. Elle repose sur le principe de la plasticité cérébrale, c’est-à-dire la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions pour compenser les zones défaillantes. C’est un peu comme entraîner un muscle, mais ici c’est le cerveau qui est en rééducation.
Cette rééducation est généralement menée par un orthoptiste spécialisé et peut inclure des exercices pour renforcer l’oculomotricité (mouvements des yeux), améliorer la coordination œil-main, et développer des stratégies de compensation. Elle peut être complétée par de l’ergothérapie pour adapter l’environnement du patient, ou d’autres thérapies selon les besoins spécifiques. L’objectif est de rendre au quotidien plus de fluidité et de confiance, en développant des outils pour mieux gérer les défis visuels.